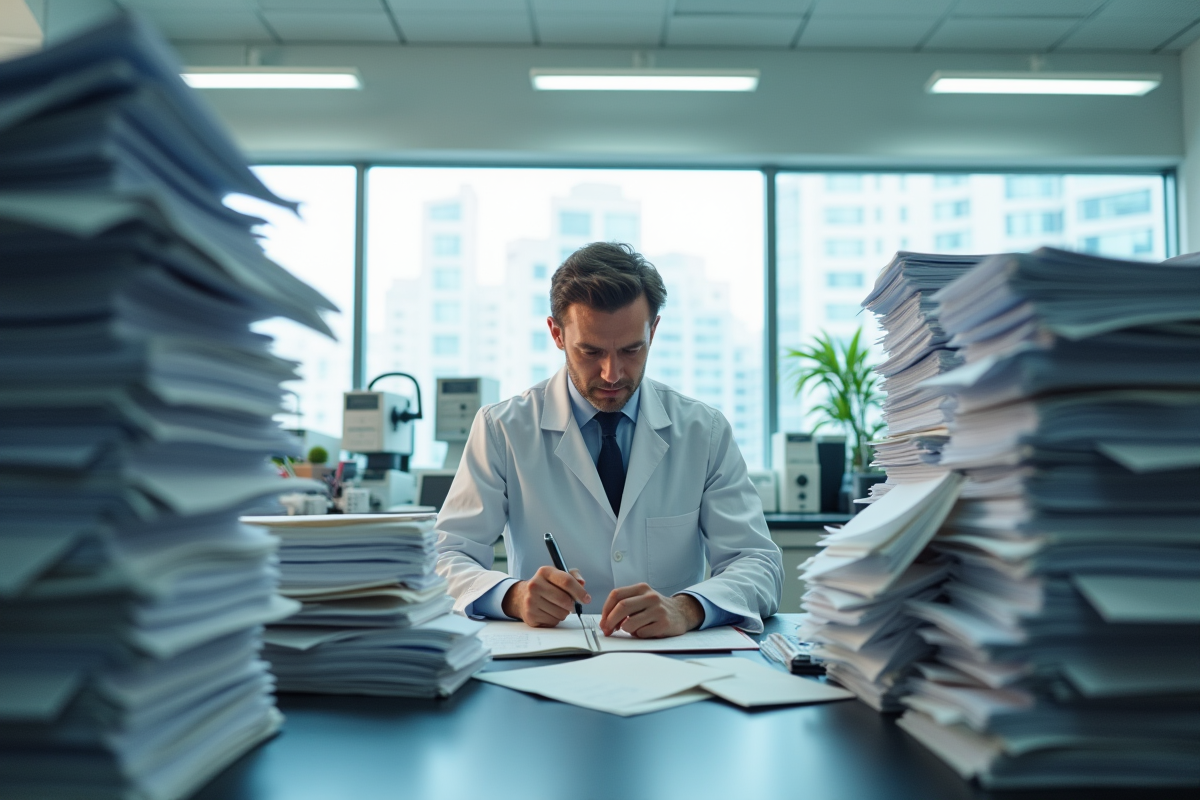Des chercheurs en éducation pris au piège d’une bureaucratie galopante : voilà le quotidien d’une grande partie de la communauté scientifique aujourd’hui. Le temps consacré aux dossiers, aux rapports, aux impératifs de suivi administratif, grignote chaque semaine les heures qui devraient être réservées à l’enquête, à l’observation, à la réflexion. L’accès aux données, souvent verrouillé par des impératifs réglementaires ou des considérations éthiques, ralentit considérablement la marche des projets.
Les financements, conditionnés par les appels à projets toujours plus compétitifs, orientent la recherche vers des sujets porteurs, parfois au détriment de démarches plus fondamentales ou ancrées dans la réalité du terrain. Résultat : le système de priorités impose sa logique et limite la capacité à produire un savoir réellement utile pour transformer le système éducatif.
Pourquoi la recherche en éducation rencontre-t-elle tant d’obstacles ?
Dans l’univers des sciences de l’éducation, on retrouve un entrelacs de disciplines et de terrains d’étude qui rend la construction de protocoles solides bien plus épineuse qu’il n’y paraît. Les chercheurs avancent sur des sables mouvants institutionnels, où la recherche scientifique se retrouve souvent poussée à l’arrière-plan par une gestion administrative toujours plus chronophage et des logiques comptables. En France, difficile d’obtenir un accès direct aux données recueillies directement sur le terrain : écoles, universités ou établissements spécialisés. Ailleurs, comme à Montréal, des dispositifs d’observation beaucoup plus souples favorisent l’innovation et accélèrent les démarches.
Les obstacles ne se réduisent jamais à la dimension financière. La recherche éducative se confronte aussi à des exigences éthiques strictes, garantes de l’anonymat et de la sécurité des données recueillies. La prudence, même nécessaire, alourdit les circuits, freine la publication et restreint la transmission des expériences d’un établissement à l’autre. Les chercheurs en sciences humaines et sociales s’égarent parfois dans la complexité des dispositifs de soutien, dispersés sur tout le territoire et peu lisibles au niveau européen. Quant aux appels à projets, ils balisent étroitement le champ des possibles en écartant les recherches exploratoires ou fondamentales.
À l’international, la donne n’est pas plus simple. L’Europe multiplie les alliances et les dispositifs pour tenter de rivaliser avec les États-Unis, mais les ressources restent limitées. Que ce soit pour accéder aux données de recherche ou valoriser les résultats, les universités françaises bataillent avec un système rigide, souvent éloigné du modèle nord-américain. Au final, cette mécanique pousse vers une course à la publication où la quantité prime trop souvent sur l’exigence scientifique.
À tout cela s’ajoute le bouleversement des technologies : généralisation du numérique, réseaux haut débit, multiplication de la fibre… Le quotidien des chercheurs évolue au même rythme que les débats sur la répartition des fréquences en Europe. Harmoniser l’équipement, démocratiser l’accès, permettre à chacun de disposer d’outils performants : tout cela reste, aujourd’hui, un défi considérable.
Les défis concrets auxquels font face les chercheur·e·s : entre manque de moyens, contraintes institutionnelles et enjeux éthiques
Sur le terrain, les chercheurs en éducation voient se dresser de multiples obstacles. Le manque de moyens se manifeste partout : laboratoires sous-dotés, matériel parfois vétuste, accès restreint à certains jeux de données, temps alloué à la recherche qui s’amenuise sous le poids administratif. Pour qui a pris la peine de comparer une université française avec un grand établissement nord-américain, le contraste saute aux yeux, budgets éparpillés, financements incertains, reconnaissance institutionnelle trop variable, en particulier dans la recherche en formation ou lors de la formation initiale des enseignants.
D’autres freins, réglementaires ou politiques, aggravent la situation. Les critères définis par l’enseignement supérieur privilégient systématiquement des projets ciblés, et laissent de côté la recherche fondamentale ou l’analyse didactique approfondie. Conséquence : la recherche éducative marque difficilement le quotidien des professionnels et ne transforme qu’à la marge les pratiques sur le terrain. Le fossé entre les attentes du milieu scolaire et les réponses universitaires ne cesse de se creuser.
Sur le plan éthique, chaque étape devient un parcours du combattant. Mettre en place une collecte rigoureuse de données probantes s’accompagne de protocoles exigeants qui assurent le respect et la sécurité des personnes concernées. Les délais pour accéder à certaines structures scolaires allongent considérablement la durée des projets. Publier ensuite dans une revue reconnue suppose une méthodologie impeccable et peu de tolérance pour les démarches innovantes. Que l’on soit à Paris, Montréal ou Bruxelles, la valorisation des résultats de recherche se heurte souvent à la lenteur des commissions d’évaluation et à la rigidité administrative.
Et si on repensait ensemble les conditions de la recherche pour faire bouger les lignes ?
La recherche scientifique s’adapte en temps réel à un paysage mouvant, où de nouveaux réseaux et des marchés inédits changent la donne. Le télétravail, adopté à grande échelle, s’appuie sur l’accélération des télécommunications et la généralisation d’Internet. Les expériences menées en télésanté ou téléenseignement prouvent que des dynamiques collectives inédites émergent et modifient en profondeur les règles du jeu universitaire.
Pourtant, la France garde un temps de retard dans la couverture en Internet très haut débit, un frein réel à la circulation des savoirs et à la synergie avec les partenaires internationaux. Coûts élevés, modèles tarifaires rigides : tout cela pèse lourd en comparaison avec la rapidité de réaction qu’on observe aux États-Unis ou au Canada. Sur le continent européen, la gestion des fréquences fait l’objet d’une attention croissante pour tenter d’encourager la concurrence face aux géants nord-américains.
Deux transformations majeures modifient désormais en profondeur l’organisation de la recherche :
- Le télétravail facilite les échanges et encourage une recherche décloisonnée, nourrie par des collaborations à distance plus organiques.
- Les secteurs porteurs, comme le téléenseignement ou la télésanté, favorisent l’émergence de nouveaux partenariats et ouvrent des espaces inédits de partage de pratiques.
La miniaturisation des outils, la réduction des coûts d’équipement et l’utilisation croissante de réseaux hybrides (fibre et cuivre) bouleversent le quotidien académique. Les coopérations qui se tissent déjà entre Rouen, Montréal ou Bruxelles donnent un avant-goût des bénéfices d’un décloisonnement des méthodes et des terrains. Saisir cette occasion, c’est offrir à la recherche en sciences de l’éducation la possibilité d’inventer, d’oser et, peut-être, d’atteindre ces découvertes qu’on jugeait hors d’atteinte il y a peu.